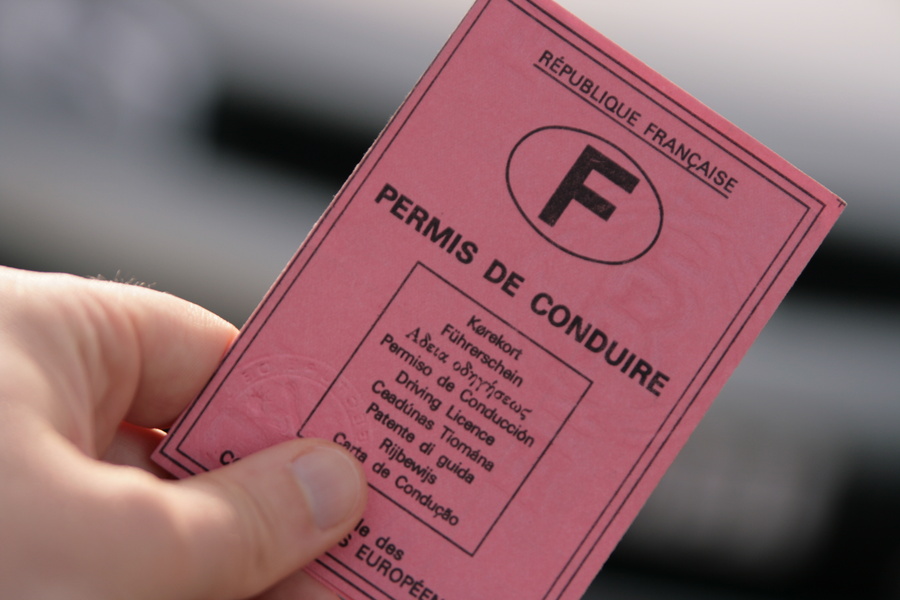Le 27 mars 2025, la commission spéciale de l’Assemblée nationale a voté la suppression des Zones à Faibles Émissions (ZFE) dans le cadre du projet de loi sur la simplification de la vie économique. Cette décision, qui doit encore être validée par le Parlement, relance le débat entre justice sociale, liberté de circuler et impératifs environnementaux.
Mais en quoi consistent exactement les ZFE ? Pourquoi sont-elles remises en cause ? Et quelles seraient les conséquences concrètes pour les automobilistes français ? Guichet Carte Grise fait le point.
Qu’est-ce qu’une Zone à Faibles Émissions (ZFE) ?
Les ZFE, introduites par la loi d’orientation des mobilités (LOM), sont des zones urbaines dans lesquelles la circulation des véhicules les plus polluants est restreinte, en fonction de leur classification Crit’Air. Elles remplacent les anciennes Zones à Circulation Restreinte (ZCR).
Ce dispositif a été conçu pour répondre à une urgence sanitaire : selon Santé publique France, la pollution de l’air est responsable de plus de 40 000 décès prématurés par an. Il vise à améliorer la qualité de l’air en incitant à un renouvellement du parc automobile vers des véhicules plus propres.
Les véhicules sont classés de Crit’Air 0 (électriques et hydrogène) à Crit’Air 5 (diesels les plus anciens), et certaines catégories peuvent être interdites dans les ZFE.
Un dispositif imposé par les normes européennes… mais déjà contesté
La mise en place des ZFE répond aussi à une contrainte juridique : l’État français a été plusieurs fois condamné pour dépassement des seuils de pollution, notamment par une décision du Conseil d’État du 24 novembre 2023.
La directive européenne du 21 mai 2008 impose un seuil limite de 40 µg/m³ pour le dioxyde d’azote (NO₂), contre 10 µg/m³ recommandé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En cas de non-respect, la France risque de lourdes amendes de la part de l’Union européenne.
Une application encore limitée… sauf à Paris et Lyon
En théorie, depuis la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, les agglomérations de plus de 150 000 habitants dépassant régulièrement les seuils de pollution devaient mettre en place une ZFE. Cela concernait 42 villes, dont Marseille, Strasbourg ou encore Toulouse.
En pratique, seules Lyon et Paris appliquent réellement des restrictions strictes. Dans d’autres agglomérations, le dispositif a été reporté, édulcoré, voire suspendu. En mars 2024, le gouvernement a annoncé la sortie de l'obligation pour Marseille, Rouen et Strasbourg à compter du 1er janvier 2025.
Pourquoi vouloir supprimer les ZFE aujourd’hui ?
La suppression des ZFE, votée en commission à l’Assemblée nationale, s’appuie sur des arguments sociaux et économiques :
- Inégalité d’accès à la mobilité : selon une consultation citoyenne du Sénat (mai 2023), 86 % des participants étaient opposés aux ZFE, invoquant leur impact sur les ménages modestes incapables de changer de véhicule.
- Manque d’alternatives crédibles : transports en commun insuffisants, infrastructures inadaptées, zones périurbaines mal desservies…
- Coût des véhicules propres : malgré les aides (bonus écologique, prime à la conversion), le coût d’un véhicule neuf reste prohibitif pour de nombreux foyers.
Les députés Les Républicains (LR) et Rassemblement national (RN) dénoncent une « ségrégation sociale et territoriale », et estiment que les ZFE limitent « la liberté d’entreprendre » et « la liberté de circuler ».
Des conséquences majeures pour la qualité de l’air… et les automobilistes
Si la suppression est définitivement votée, plus de 2,7 millions de véhicules actuellement restreints pourraient à nouveau circuler librement dans les métropoles. Cela concerne notamment :
- Les agglomérations comme Montpellier, Grenoble, Paris et Lyon, où près d’un quart des véhicules polluants pourraient réapparaître dans le trafic
- Les zones où seuls les véhicules utilitaires sont concernés (Nancy, Clermont-Ferrand) seront peu affectées
Cette réintroduction massive soulève une inquiétude environnementale majeure : le recul des progrès réalisés en matière de qualité de l’air, particulièrement à Paris et Lyon, où les concentrations de NO₂ ont baissé d’un tiers depuis la mise en place des ZFE, selon le ministère de la Transition écologique.
Lire aussi : Quelles villes interdisent les voitures diesel ?
La vignette Crit'Air : de son rôle actuel à ses perspectives d'avenir
Qu'est-ce que la vignette Crit'Air ?
La vignette Crit'Air est un dispositif visant à classer les véhicules en fonction de leur niveau d’émissions polluantes. Elle permet aux autorités locales de mettre en place des restrictions de circulation dans les ZFE.
Les véhicules sont répartis en six catégories (Crit'Air 0 à Crit'Air 5), avec des restrictions plus sévères pour les véhicules les plus polluants. Par exemple, les véhicules Crit'Air 3, 4 et 5 peuvent être interdits de circulation dans les ZFE lors des pics de pollution.
Quel impact pour les automobilistes et les deux-roues en 2025 ?
Les automobilistes de véhicules anciens (Crit'Air 3, 4 et 5), notamment ceux conduisant des diesels ou des voitures à essence anciennes, risquent de se voir interdits de circulation dans certaines ZFE. Cette restriction affecte particulièrement les deux-roues motorisés anciens, qui sont souvent classés dans les catégories les plus polluantes. Pour ces conducteurs, la suppression des ZFE pourrait offrir un répit, en levant les interdictions de circulation imposées dans certaines grandes villes.
Cependant, si le dispositif des ZFE venait à disparaître, cela soulèverait des questions sur l'avenir de la vignette Crit'Air. De nombreux experts estiment que la vignette pourrait devenir obsolète, voire être remplacée par un autre dispositif de classification des émissions, surtout si les critères de pollution sont intégrés directement dans la réglementation européenne.
Dans tous les cas, l’avenir de la vignette Crit'Air et de son utilisation dans les ZFE reste incertain, en fonction des décisions à venir sur la réglementation de la mobilité et de la qualité de l’air.
Une décision à contre-courant des engagements européens
La France pourrait se retrouver en contradiction avec ses obligations européennes en matière de qualité de l’air. En cas de non-respect, elle risque de lourdes amendes de la part de la Commission européenne, comme l’a rappelé récemment le Conseil d’État.
De plus, cette décision intervient alors que l’Europe renforce ses exigences climatiques, notamment avec le Green Deal européen visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici 2030.
Quel avenir pour les automobilistes français ?
Pour les automobilistes, la suppression des ZFE pourrait à court terme représenter un soulagement, notamment pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de changer de véhicule. Mais à moyen et long terme, le retour de la pollution, les coûts sanitaires, et l’incertitude réglementaire risquent de peser davantage sur les usagers.
Les collectivités locales, quant à elles, pourraient reprendre la main pour définir des ZFE “à la carte”, comme l’a suggéré le gouvernement, avec des règles adaptées aux spécificités territoriales.
La suppression des ZFE pose une question cruciale : comment concilier urgence environnementale et justice sociale ? Les experts appellent à un renforcement des aides ciblées, au développement massif d’alternatives à la voiture individuelle, et à une stabilité réglementaire qui donne de la visibilité aux particuliers comme aux entreprises.
En attendant, le vote définitif aura lieu à l’Assemblée nationale à partir du 8 avril 2025, puis au Sénat. L’avenir des ZFE et celui de la mobilité urbaine en France se joue donc dans les prochaines semaines.